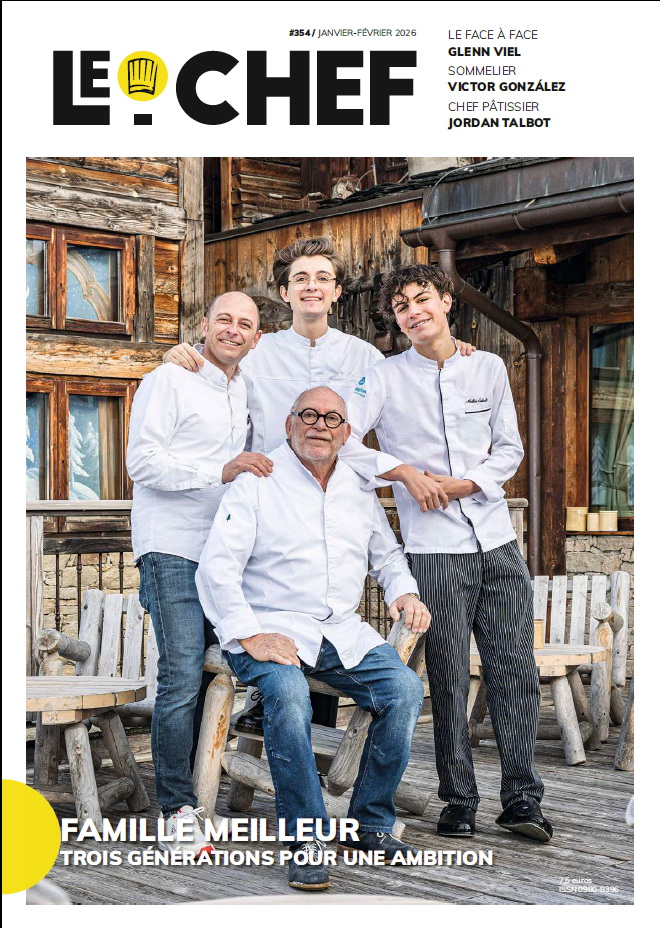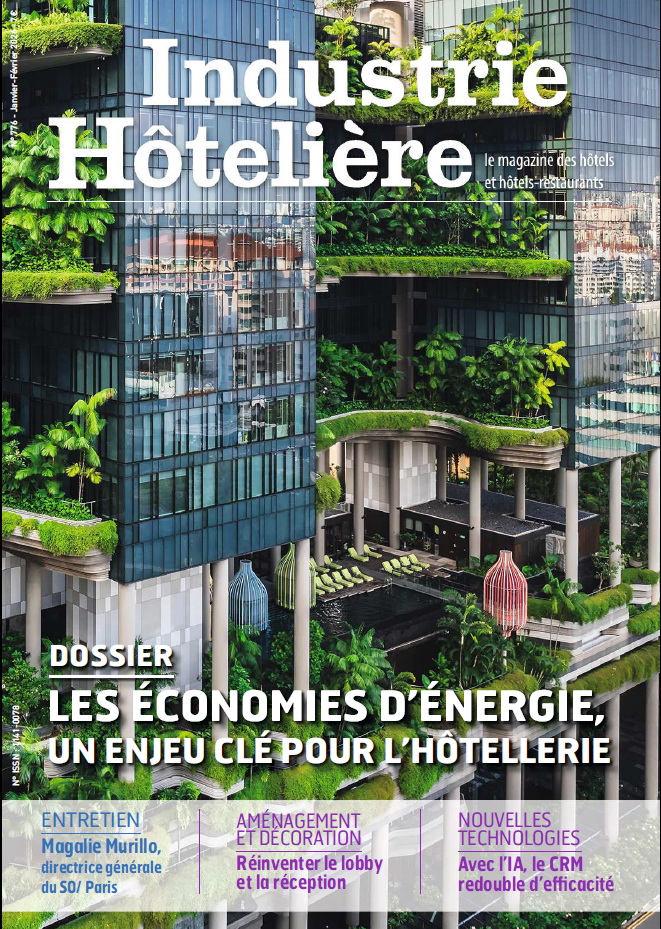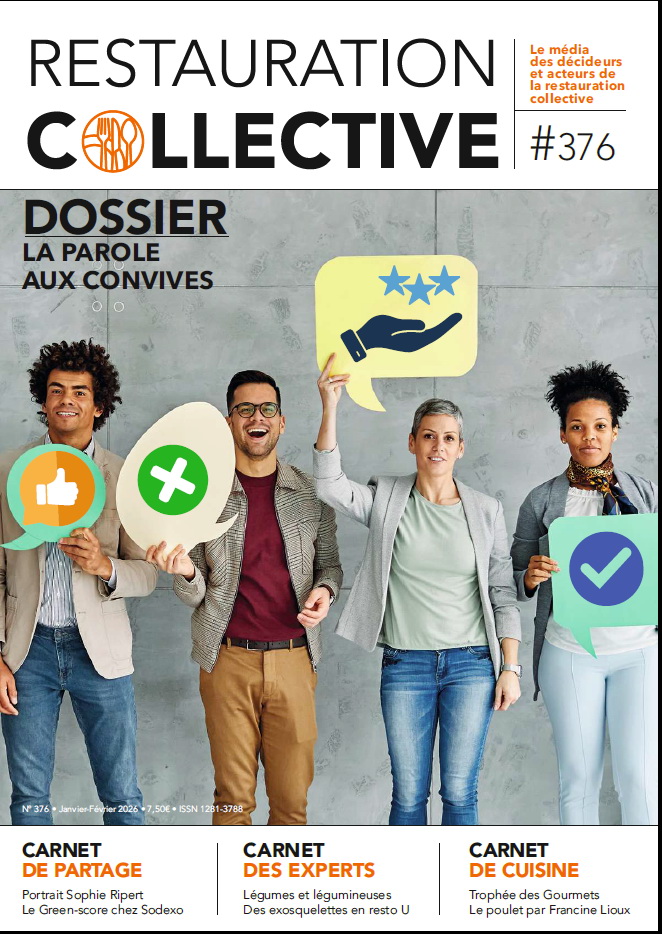L’ordonnance du 22 septembre 2017, relative au renforcement de la négociation collective et prise dans le cadre de la loi d’habilitation du 15 septembre 2017 pour le renforcement du dialogue social, entre dans le champ de la réforme dite du Code du travail.Elle comprend les matières pour lesquelles la branche professionnelle a une compétence exclusive. À partir du 1er janvier 2018, dès lors qu’un accord d’entreprise existe sur un sujet, il évince l’accord de branche, peu importe qu’il soit plus ou moins favorable que ce dernier, et peu importe leurs dates de conclusion respectives. Ce principe connaît toutefois trois dispositions distinctes comportant des séries d’exception.
Domaines pour lesquels les accords de branche s’imposent aux accords d’entreprise
Les ordonnances sont venues enrichir la liste des garanties pour lesquelles la loi impose aux négociateurs d’entreprise le respect des conventions et accords collectifs de branche.
Elle classe ces garanties dans les dix catégories suivantes :
• les salaires minima hiérarchiques ;
• les classifications ;
• la mutualisation des fonds de financement du paritarisme ;
• la mutualisation des fonds de la formation professionnelle ;
• les garanties collectives complémentaires ;
• les conditions et durées de renouvellement de la période d’essai dans un contrat de travail ;
• les modalités de transfert conventionnel des contrats de travail ;
• en matière de durée du travail :
• les dispositions fixant la période de référence en cas de répartition de la durée du travail sur une durée supérieure à la semaine ;
• les dispositions instituant un régime d’équivalence ;
• la fixation du nombre minimal d’heures entraînant la qualification de travailleur de nuit,
• s’agissant du travail à temps partiel, les dispositions relatives à la durée minimale de travail hebdomadaire, à la majoration des heures complémentaires et aux conditions dans lesquelles peuvent être conclus des avenants au contrat pour augmenter temporairement la durée de travail ;
• les dispositions relatives aux durées maximales des contrats à durée déterminée, au délai de transmission du contrat au salarié ainsi qu’aux délais de carence entre deux contrats, ainsi que, pour les contrats de travail temporaire, les dispositions relatives aux durées maximales des contrats de mission, à leur renouvellement et aux délais de carence à respecter entre deux contrats ;
• les dispositions relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
En outre, précisons qu’un accord d’entreprise, existant ou à venir, peut s’appliquer à la place de l’accord branche dès lors qu’il présente des garanties au moins équivalentes à celles prévues par l’accord de branche. L’ordonnance a substitué cette nouvelle notion de garanties au moins équivalentes à celle de disposition plus favorable.
Domaines pour lesquels les accords de branche peuvent s’imposer aux accords d’entreprise
Les dispositions de la loi Travail qui imposaient aux négociateurs de branche de négocier le contenu de « l’ordre public conventionnel » sont abrogées par l’ordonnance. Pour autant, le concept ne disparaît pas totalement puisque l’ordonnance prévoit expressément la possibilité pour les partenaires sociaux de faire primer l’accord de branche sur l’accord d’entreprise, sauf si ce dernier comprend des garanties au moins équivalentes.
Cette possibilité concerne les dispositions relatives :
• au seuil de désignation des délégués syndicaux (DS), au nombre de DS et à la valorisation de leur parcours syndical ;
• à la prime pour travaux dangereux ou insalubres ;
• à la prévention de l’exposition aux facteurs de risques professionnels ;
• à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.
Domaines pour lesquels les accords d’entreprise primeront sur l’accord de branche
Les matières concernées sont celles qui ne sont pas listées dans les deux précédents domaines cités ci-dessous.
L’ordonnance prévoit que l’accord d’entreprise prévaudra sur l’accord de branche qu’il soit conclu avant ou après la date d’entrée en vigueur de l’accord de branche. En l’absence d’accord d’entreprise, c’est l’accord de branche qui s’appliquera.
Afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise ou en vue de préserver, ou de développer l’emploi, un accord d’entreprise pourra aménager la durée du travail, ses modalités d’organisation et de répartition, aménager la rémunération et déterminer les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique.
L’accord d’entreprise s’imposera aux salariés qui, en cas de refus, pourront être licenciés pour cause réelle et sérieuse. Les salariés disposeront d’un mois pour faire part de leur refus. Ils toucheront l’assurance chômage et bénéficieront d’un droit à 100 heures de formation financées par l’employeur.
Par ailleurs, il reviendra à la personne qui conteste la légalité d’un accord collectif d’apporter la preuve que l’accord n’a pas été négocié ou conclu conformément au Code du travail. Toute action devra être engagée avant l’expiration d’un délai de deux mois :
• pour les accords d’entreprise, soit à compter de la procédure de notification à l’ensemble des organisations représentatives pour les organisations disposant d’une section syndicale, soit à partir de la date de publicité de l’accord dans la nouvelle base de données publique ;
• pour les accords de branche, à compter de leur date de publicité dans la base de données publique.
L’ordonnance prévoit de moduler les effets de la nullité de l’accord, si l’effet rétroactif de cette annulation entraîne des conséquences excessives. Le juge pourra ne donner effet à la nullité que pour l’avenir ou dans le temps.
Source : Direction de l’information légale et administrative
Mise en place du CSE dans les entreprises d’au moins 11 salariés
Le Comité économique et social (CSE) doit être mis en place dans toutes les entreprises d’au moins 11 salariés d’ici le 1er janvier 2020. Il remplace les représentants élus du personnel dans l’entreprise et fusionne l’ensemble des instances représentatives du personnel (IRP), délégués du personnel (DP), comité d’entreprise (CE) et comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Le CSE comprend l’employeur et une délégation du personnel. Le CSE a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Attributions du CSE
La délégation du personnel au CSE a pour mission de présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du Code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l’entreprise. Elle contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l’entreprise et réalise des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
Organisation générale de l’entreprise
Le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur :
» les orientations stratégiques de l’entreprise ;
» la situation économique et financière de l’entreprise ;
» les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
» les conditions de santé et de sécurité ;
» la mise en œuvre des moyens de contrôle de l’activité des salariés ;
» la restructuration et compression des effectifs ;
» le licenciement collectif pour motif économique ;
» l’offre publique d’acquisition.
Élection des membres du CSE
Dans les entreprises de plus de 11 salariés, l’employeur organise tous les 4 ans l’élection des membres du CSE. En dessous de 11 salariés, l’élection est facultative. Un CSE peut être constitué par convention ou accord collectif de travail. L’élection a lieu au scrutin secret sous enveloppe ou par vote électronique. Le délégué syndical est membre de droit du CSE. Le médecin du travail et le responsable interne du service de sécurité assistent aux réunions du CSE relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail.
Droit d’alerte
Le CSE bénéficie d’un droit d’alerte :
» en cas d’atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l’entreprise ;
» en cas de danger grave et imminent en matière de santé publique et d’environnement ;
» s’il a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise ou de faits susceptibles de caractériser un recours abusif aux contrats de travail à durée déterminée (CDD).
Inspection du travail
Les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent saisir l’inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l’application des dispositions légales dont elle est chargée d’assurer le contrôle. Lors des visites de l’agent de contrôle de l’inspection du travail, les membres de la délégation du personnel au CSE sont informés de sa présence par l’employeur et peuvent présenter leurs observations.