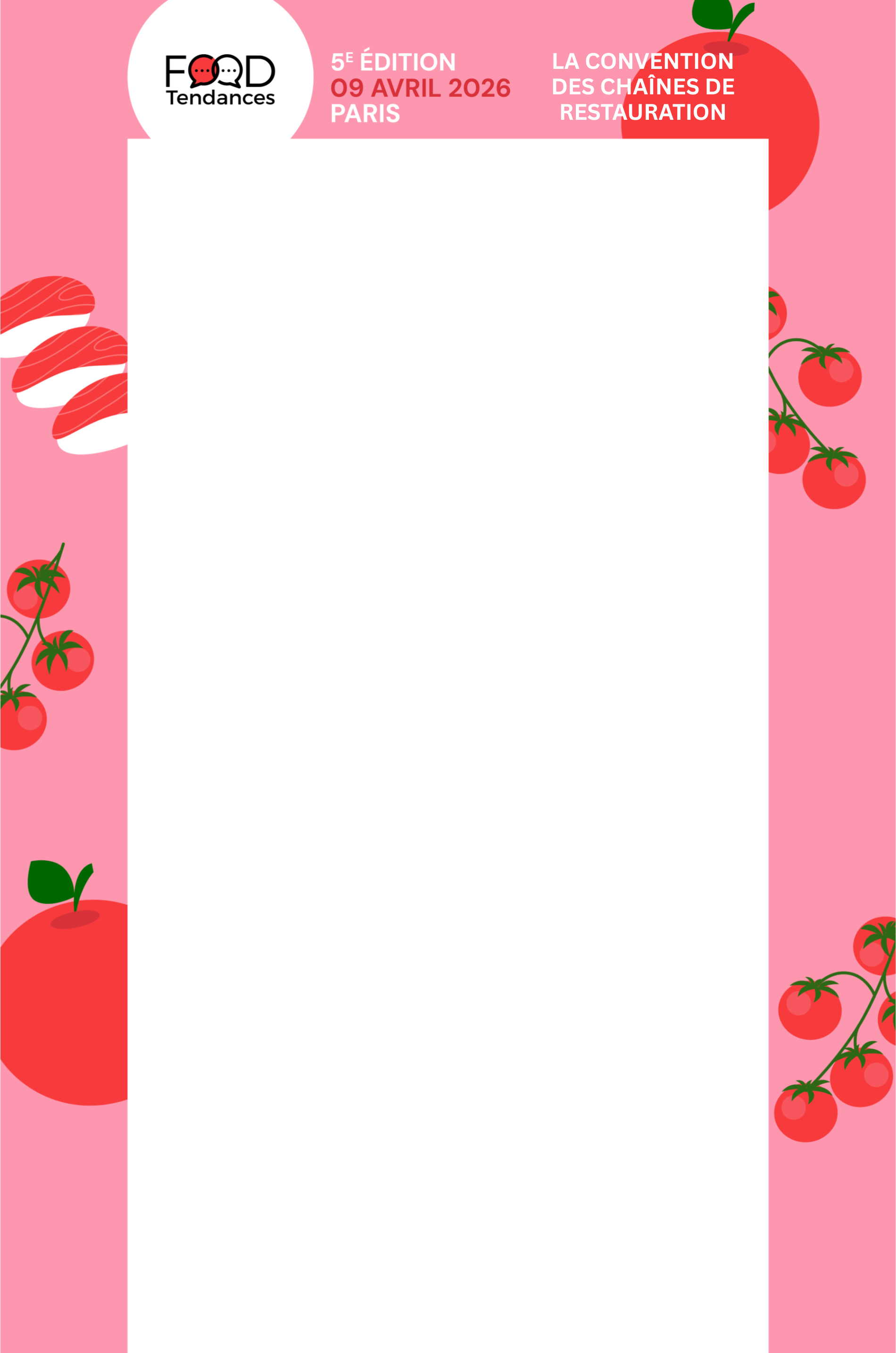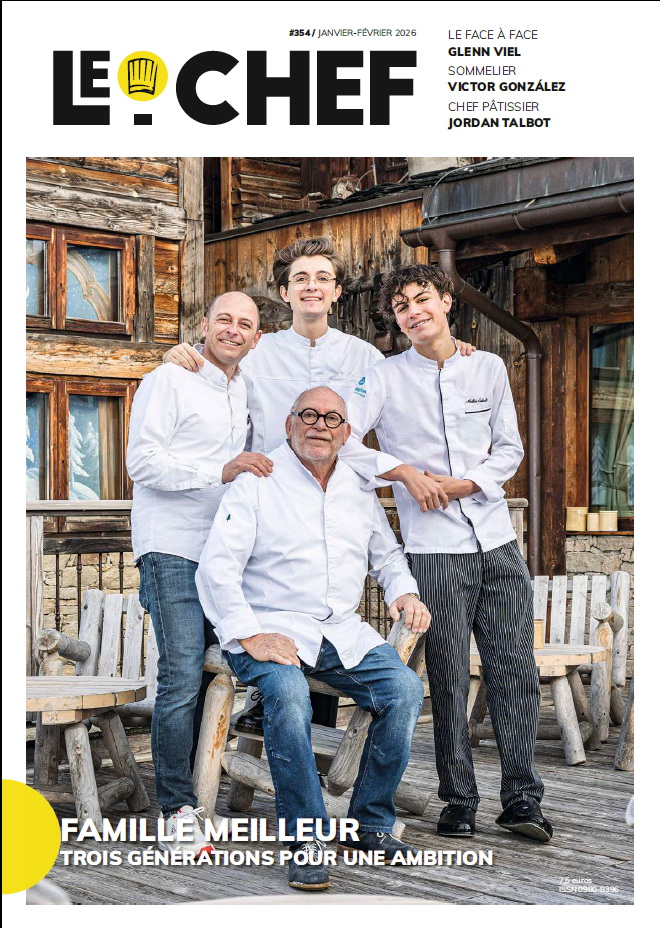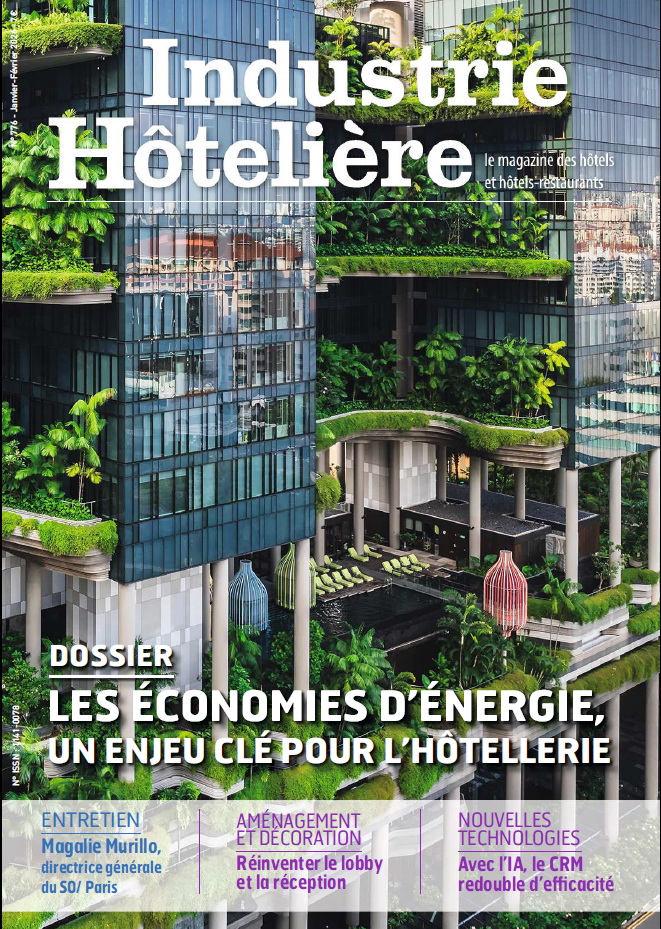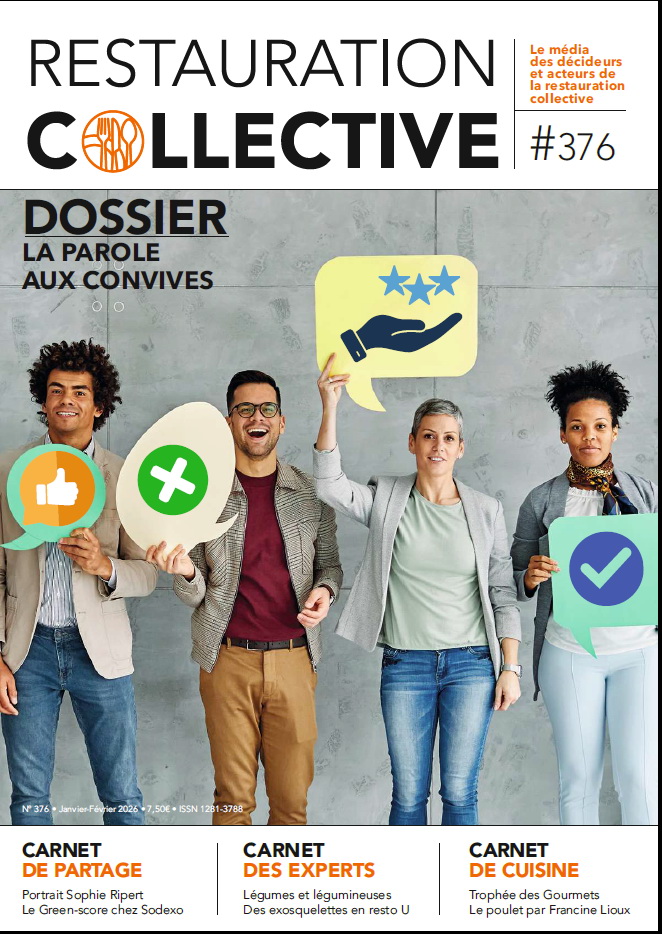Deux nouveaux barèmes pour calculer l’indemnité de licenciement versée au salarié
En cas de litige relatif à un licenciement pour motif personnel ou économique, le salarié peut éventuellement percevoir une indemnité compensatrice pour le préjudice subi. Devant les prud’hommes, cette indemnité peut être fixée : devant le bureau de conciliation dans le cadre d’un accord entre l’employeur et le salarié ; par le juge lorsque l’affaire est portée devant le bureau de jugement, faute d’accord.
Un premier décret du 23 novembre 2016 (n° 2016-1581) révise le barème permettant de calculer l’indemnité forfaitaire de conciliation prévu à l’article L. 1235-1 du Code du travail.
Un second décret du 23 novembre 2016 (n° 2016-1582), issu de la loi Macron, modifie le barème de l’indemnité forfaitaire de conciliation fixé à l’article D. 1235-21 du Code du travail.
Ces dispositions sont applicables à compter du 26 novembre 2016.
Indemnité forfaitaire de conciliation
L’employeur et le salarié peuvent, s’ils le souhaitent, décider de mettre un terme à leur conflit en contrepartie du versement par l’employeur au salarié d’une indemnité forfaitaire, fixée en référence à un barème qui tient compte de l’ancienneté dans l’entreprise. Il ne s’impose ni au salarié ni à l’employeur et sert uniquement à les aider dans leurs négociations sur le montant de l’indemnité accordée (le référentiel indicatif est mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 1235-1 du Code du travail).
L’indemnité forfaitaire de conciliation s’ajoute aux indemnités déjà versées ou restant dues au salarié (indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et de préavis, indemnité contractuelle de non-concurrence…).
Pour en savoir plus sur ce nouveau barème d’indemnité forfaitaire de conciliation, vous pouvez consulter le décret mis en ligne par Legifrance Journal officiel
https ://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033472038&fastPos=1&fastReqId=1977827808&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
Référentiel indicatif prud’homal
En cas de litige relatif à un licenciement entre l’employeur et le salarié lors de la phase de conciliation, l’affaire arrive alors devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui va :
- apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur ;
- fixer, le cas échéant, les dommages et intérêts à verser au salarié.
Lorsque la conciliation n’aboutit pas, le conseil tranche le litige et, si cela apparaît justifié, attribue au salarié des indemnités. La loi dite « loi Macron » a prévu que le montant de ces indemnités soit fixé à partir d’un référentiel indicatif, voire par la seule application de ce référentiel, si les parties en font conjointement la demande.
Le référentiel fixe le montant de l’indemnité en nombre de mois de salaire variable selon l’ancienneté. Le montant de l’indemnité varie ainsi d’un mois de salaire pour les salariés justifiant de moins d’un an d’ancienneté à 21,5 mois de salaire pour les salariés justifiant de 43 ans et plus d’ancienneté.
Les montants indiqués dans le référentiel sont majorés d’un mois :
• lorsque le demandeur est âgé d’au moins 50 ans à la date de la rupture du contrat ;
• en cas de difficultés particulières de retour à l’emploi du demandeur tenant à sa situation personnelle et à son niveau de qualification.
Enfin, rappelons que l’indemnité forfaitaire de conciliation s’ajoute aux indemnités déjà versées ou restant dues au salarié (indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et de préavis, indemnité contractuelle de non-concurrence…).
Précisons que le juge est libre de ne pas se conformer au référentiel d’indemnisation sauf si l’employeur et le salarié demandent conjointement à ce qu’il soit appliqué. Les dommages et intérêts en cause s’ajoutent aux indemnités de licenciement légales, conventionnelles ou contractuelles.
Pour en savoir plus sur ce nouveau référentiel indicatif prud’homal, vous pouvez consulter le décret mis en ligne par Legifrance Journal officiel
https ://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033472046&fastPos=1&fastReqId=1863588480&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
Des précisions sur le licenciement économique
L‘article 67 de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels est venue préciser dans l’article L. 1233-3 du Code du travail applicable à compter du 1er décembre 2016, la définition du motif économique du licenciement ainsi que la notion de difficultés économiques.
Définition
Constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression, d’une transformation d’emploi ou d’une modification, refusées par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à :
- des difficultés économiques qui devront répondre à des critères déterminés par la loi ;
- des mutations technologiques ;
- une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
- la cessation d’activité de l’entreprise.
Périmètres d’application
Désormais la loi précise, toujours de manière non exhaustive, que celles-ci peuvent être caractérisées par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel que :
- une baisse des commandes ;
- une baisse du chiffre d’affaires ;
- des pertes d’exploitation ;
- une dégradation de la trésorerie ;
- une dégradation de l’excédent brut d’exploitation.
Les difficultés économiques s’apprécient au moment du licenciement. Si les difficultés économiques continuent de s’apprécier dans le secteur d’activité du groupe auquel appartient l’entreprise, la matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécient en revanche au niveau de l’entreprise.
Il convient également de rappeler que la cause économique doit avoir un impact ou une incidence sur l’emploi du salarié : suppression de poste, transformation d’emploi du salarié ou modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail.
La baisse du chiffre d’affaires ou du carnet de commandes pouvant notamment caractériser les difficultés économiques est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, par rapport à la même période de l’année précédente, au moins égale à :
- 1 trimestre pour une entreprise de moins de 11 salariés ;
- 2 trimestres consécutifs pour une entreprise entre 11 et 49 salariés ;
- 3 trimestres consécutifs pour une entreprise entre 50 et 299 salariés ;
- 4 trimestres consécutifs pour les entreprises de 300 et plus.
Pouvoirs du juge
La nouvelle définition des causes économiques de licenciement se veut plus précise et sécurisante pour l’employeur. Toutefois, le pouvoir d’appréciation du juge reste important.
En premier lieu, la liste légale des causes économiques de licenciement reste non limitative, et pourra donc être complétée ultérieurement par la jurisprudence. D’autre part, en matière de difficultés économiques, il appartiendra au juge d’apprécier le caractère « significatif » de l’évolution des indicateurs.
Source : Direction des affaires sociales du Synhorcat
Publication des décrets relatifs à la durée du travail
Deux décrets n° 2016-1551 et n° 2016-1553 du 18 novembre 2016 portant diverses mesures relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés, pris en application de la loi « Travail » du 8 août 2016, ont modifié la partie réglementaire du Code du travail.
Ces décrets recodifient à droit constant les dispositions relatives à la durée du travail en respectant le nouvel agencement, introduit par la loi « Travail », qui distingue les dispositions d’ordre public, celles relevant du champ de la négociation collective et les dispositions supplétives ne s’appliquant qu’à défaut d’accord collectif.
Les deux décrets applicables à compter du 1er janvier 2017, interviennent à la suite de la réécriture de la partie législative du Code du travail par l’article 8 de la loi 2016-1088 du 8 août 2016.
Ces textes apportent également quelques aménagements aux règles en vigueur :• Durée maximale quotidienne et hebdomadaire. Dans les différents articles insérés dans la partie réglementaire du Code du travail en traitant, le terme « dérogation » est remplacé par celui de « dépassement » devant faire l’objet d’une « autorisation ».• Dépassement de la durée moyenne de 44 heures.
La loi du 8 août 2016 a offert la possibilité de déroger par accord d’entreprise ou, à défaut, par accord de branche à la durée maximale de 44 heures sur 12 semaines à condition que cette durée ne dépasse pas 46 heures sur la même période (art. L 3121-23 du Code du travail). Elle a également créé une règle supplétive. À défaut d’accord, le dépassement de cette durée maximale peut être autorisé par l’autorité administrative dans la même limite (art. L 3121-24 du Code du travail).• Documents fournis à l’inspecteur du travail. En matière de contrôle de la durée du travail, l’employeur doit, entre autres, tenir à la disposition de l’inspection du travail, pendant une durée d’un an, y compris dans le cas d’horaires individualisés ou, ajoute l’un des décrets, « pendant une durée équivalente à la période de référence en cas d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à l’année », les documents existant dans l’entreprise ou l’établissement permettant de comptabiliser les heures de travail accomplies par chaque salarié (art. D. 3171-16 modifié du Code du travail).• Récupération des heures perdues. Dans la partie réglementaire du Code du travail également, un nouvel article prévoit que « l’inspecteur du travail [devra désormais être] préalablement informé par l’employeur des interruptions collectives de travail et des modalités de la récupération. Si le travail est interrompu par un événement imprévu, l’information [devra être] donnée immédiatement » (art. R. 3121-33 à venir du Code du travail).• Négociation collective en matière d’astreinte.
La loi du 8 août 2016 a modifié le champ de la négociation collective en matière d’astreinte. Désormais, l’accord collectif peut déterminer les modalités d’information et les délais de prévenance des salariés concernés (art. L. 3121-11 du Code du travail).
En l’absence d’accord, les modalités d’information des salariés sont fixées par le nouvel article R. 3121-3 du Code du travail. L’employeur doit communiquer, par tout moyen conférant date certaine, aux salariés concernés, la programmation individuelle des périodes d’astreinte. Cette communication doit s’effectuer dans un délai de 15 jours, ou un jour franc à l’avance en cas de circonstances exceptionnelles, conformément à l’article L. 3121-12 du Code du travail.
Actuellement, les modalités d’information des salariés sur la programmation individuelle des périodes d’astreinte sont libres en l’absence de précision dans les textes.
Notons enfin qu’à partir du 1er janvier 2017, les négociations d’accords d’entreprise, désormais prioritaires sur les accords de branche, pourront débuter.
Les décrets d’application sur les congés spécifiques (autres que les congés payés) ont été publiés
Entrant en vigueur au 1er janvier 2017, les décrets n° 2016-1552 et 2016-1555 du 18 novembre 2016 relatif aux congés autres que les congés payés présentent quelques nouveautés concernant :
• le congé de participation aux instances d’emploi et de formation ou à un jury d’examen (notification du refus de l’employeur par tout moyen permettant de la dater) ;
• le congé pour la création ou la reprise d’entreprise (possibilité pour l’employeur, à défaut d’accord, de différer le départ en congé de façon à ce que le pourcentage des salariés simultanément absents dans ce cadre-là notamment, ne dépasse pas un certain seuil).
Plus généralement, ces deux textes recodifient les dispositions réglementaires afin de les mettre en cohérence avec les dispositions.