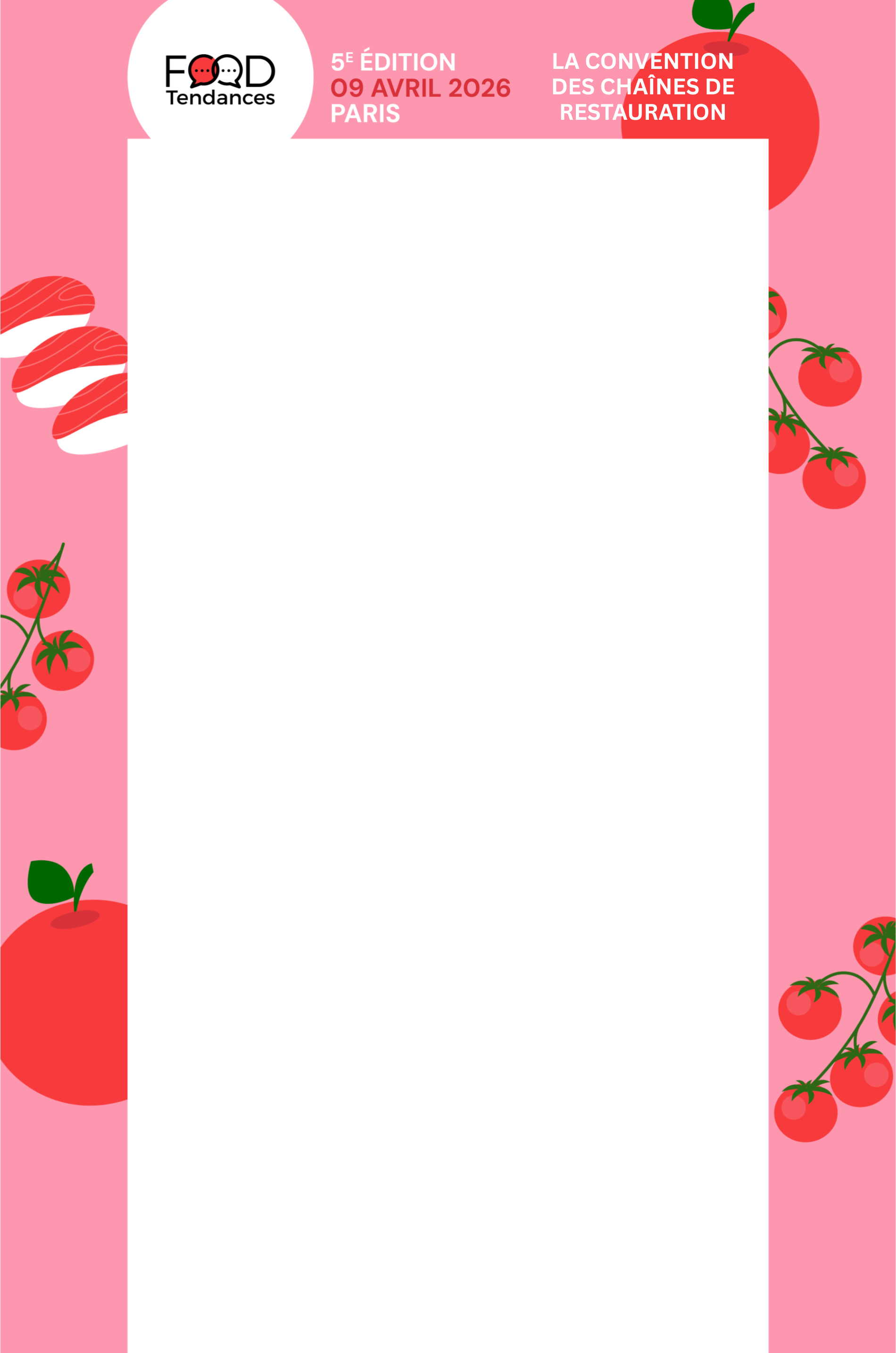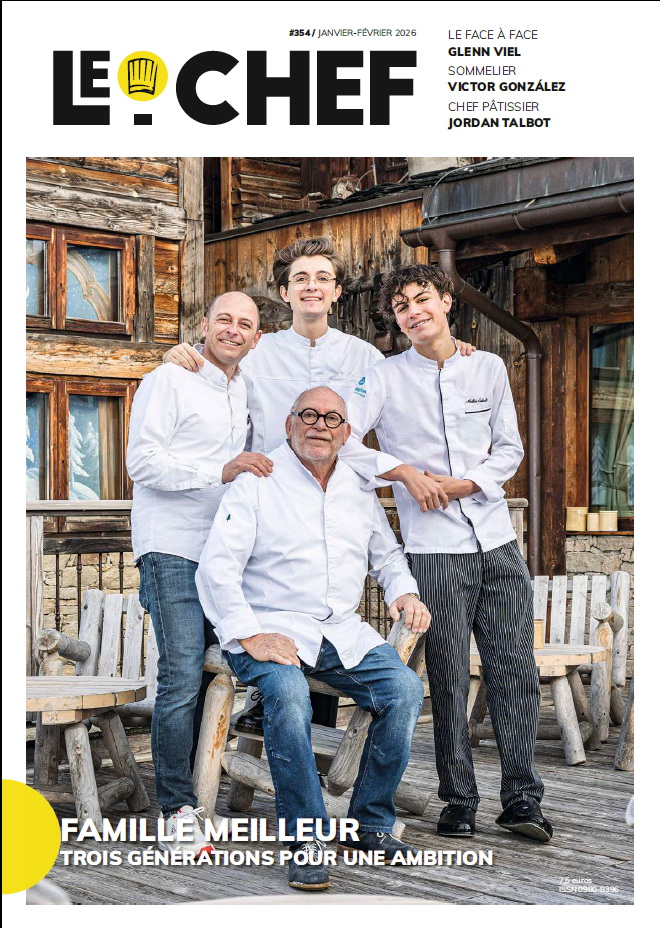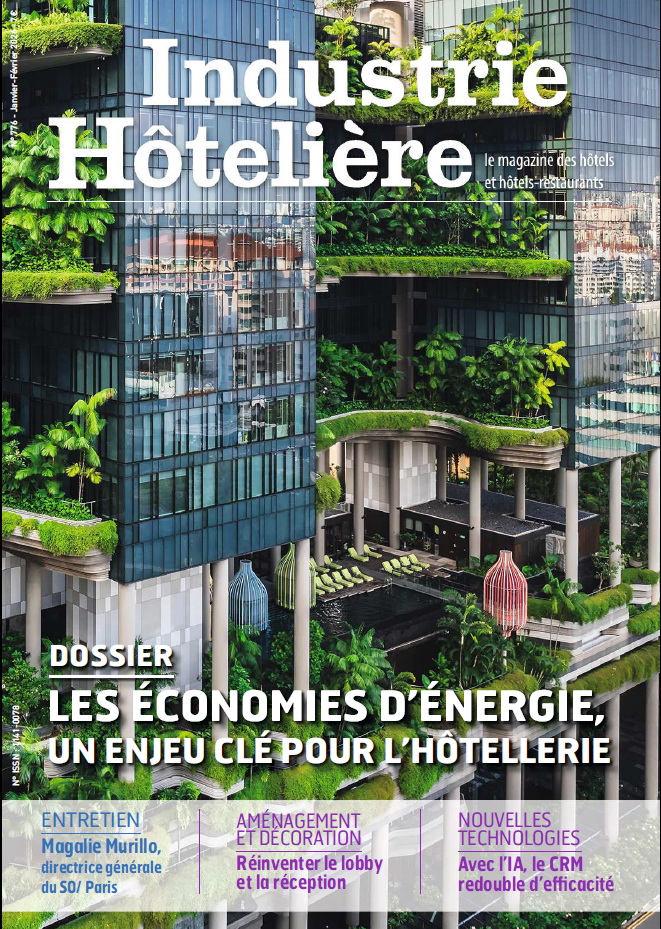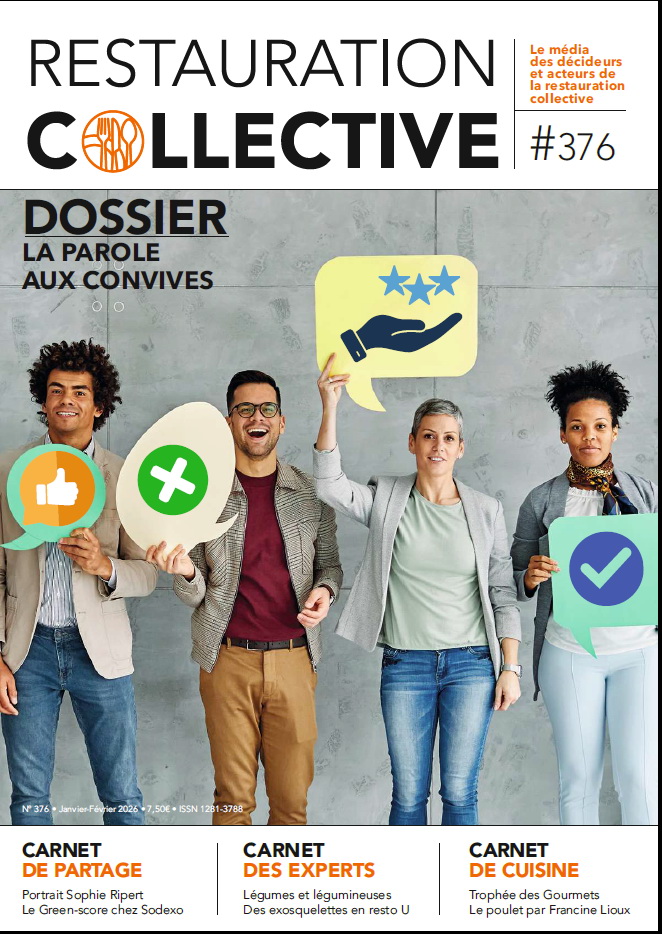À la veille de la prochaine saison estivale, certains préfets des départements du littoral ont procédé cet hiver à la démolition ou à la destruction d’une centaine de restaurants de plage installés de façon illégale depuis plus de dix ans sur les plages du domaine public notamment sur la Côte d’Azur (Ramatuelle, Cannes, Vallauris, Juan-les-Pins, Golfe-Juan), sur la Côte d’Amour, sur le pourtour du littoral méditerranéen et sur l’île de Beauté (pour les plagistes qui ne bénéficient pas d’une autorisation administrative d’occupation temporaire annuelle (AOT).
Selon la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM), ces infrastructures non démontables qui occupent le domaine public maritime sans droit ni titre, ont été rasées conformément aux dispositions du décret du 26 mai 2006 relatif aux concessions de plage pris en application de la loi de protection du littoral (art. L 321-9 du Code de l’environnement).
Pour certaines de ces structures construites en dur à même le sable, c’est l’État qui s’est chargé de la destruction de ces restaurants de plage présents sur le domaine public du littoral maritime et les travaux de démolition seront à la charge des exploitants qui ont refusé à les démolir eux-mêmes après injonction par arrêté préfectoral.
Les difficultés d’application de la loi Littoral
La loi Colbert, édictée en 1621, a rendu le domaine maritime inaliénable. La loi Littoral de 1986 prône un usage libre et gratuit de chaque plage mais le tourisme balnéaire doit satisfaire deux demandes contradictoires : tous veulent jouir d’un cadre naturel, certains souhaitent y profiter de services de proximité.
Le décret n°2006-608 du 26 mai 2006 a modifié le régime relatif aux concessions de plages, naturelles et artificielles ; il poursuit plusieurs objectifs : la libération progressive des plages, leur accès libre par le public, la responsabilisation du maire et la transparence dans l’attribution des lots (délégation de service public). Les concessions de plages doivent faire l’objet d’une concession communale ou d’une autorisation d’occupation temporaire. Les pouvoirs publics prennent en compte pour toute demande d’autorisation de l’état des lieux des concessions de plages ; c’est-à-dire de la fréquentation touristique, de la fixation des redevances, de la procédure de mise en concurrence, du démontage hivernal des constructions de plage. Il arrive parfois que le maire et l’administration préfectorale étudient les modifications demandées par les professionnels pour l’assouplissement de l’application du décret en faisant des propositions pour lever les blocages.
Précisons que le Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) a publié en mars 2009 un rapport concernant les difficultés d’application du décret du 26 mai 2006 relatif aux concessions de plages qui propose plusieurs mesures susceptibles de faciliter sa mise en œuvre du texte, tout en préservant son objectif initial prévu par loi Littoral. Mais les pouvoirs publics n’ont pas donné suite aux propositions du rapport d’où l’application stricte du décret plage au grand dam des organisations professionnelles représentant les plagistes.
Pour mémoire, le CGEDD recommandait « quelques adaptations afin de faciliter la mise en œuvre du décret sans dénaturer ses objectifs initiaux ». Il préconisait de maintenir la double limitation du taux d’occupation de chaque plage mais d’exclure du calcul du linéaire occupé les équipements publics cantonnés en fond de plage et n’entravant pas son libre accès.
Par ailleurs, il recommandait d’harmoniser les règles de gestion des plages entre les différents propriétaires publics (État, communes ou autres) et d’alléger la procédure de passation des sous-concessions, ce qui implique de réviser les redevances afin d’éviter que la quasi-totalité des sous-traités d’exploitation n’échappent à la mise en concurrence.
Les plagistes demandent la révision du décret plage
Sans remettre en cause la loi Littoral, les professionnels des restaurants de plage ont demandé au gouvernement par l’intermédiaire des instances professionnelles notamment les saisonniers, plus de souplesse dans la mise en œuvre du décret plage afin de concilier les activités économiques et les impératifs liés au domaine public maritime. Pour cela, les plagistes directement concernés par la protection de l’environnement et du littoral, ont besoin d’une réglementation adaptée pour chaque façade maritime, en tenant compte des spécificités des communes touristiques.
Ils demandent également, en concert avec certains élus des communes touristiques de la Côte d’Azur, la suspension du décret plage et la constitution d’un groupe de travail avec le gouvernement visant à modifier le décret plage en ce qui concerne la densité des plages et la démontabilité des équipements, en prenant en compte les territoires et les patrimoines.
Selon une étude Protourisme, il y a environ 1 500 plages « privées » en France dont environ un peu plus d’un tiers sur la Côte d’Azur et sur le littoral méditerranéen (hors Corse). Elles génèrent entre 600 et 800 millions d’euros de chiffre d’affaires en restauration et totalisent près de 10 000 emplois salariés.
Les attributions des plages contrôlées par les préfets
Dans cette affaire, le préfet de l’Hérault a averti, fin mars, le maire de Sète que la procédure d’attribution des plages, qui devait distribuer les emplacements à compter du 1er avril 2018 pour une durée de cinq ans (2023) a été bloquée. En cause, des irrégularités dans la procédure d’attribution des plages sétoises relevées par les services de l’État. Cette subite décision de l’autorité préfectorale qui survient à la veille du début de la saison, est contestée par le maire de Sète qui a saisi un juge des référés devant le tribunal administratif. Dans sa décision rendue le 18 avril, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande d’annulation de la procédure d’attribution des concessions de plage intentée par la préfecture pour la période 2018-2023 mais le juge des référés souligne dans sa décision que “le Préfet peut se réserver le droit de refuser l’approbation d’une convention d’exploitation à une personne (plagiste) faisant l’objet d’une procédure d’infraction au titre d’une réglementation en vigueur”.Pour la plus grande plage du littoral Atlantique à la Baule, le préfet de Loire-Atlantique a concédé après un appel d’offres, la gestion des concessions de plage à une entreprise privée pour une durée de 12 ans (la municipalité ayant décidé de renoncer à poursuivre la gestion des concessions). De ce fait, cette décision validée par le ministre de la Transition écologique a entraîné la disparition d’au moins 3 établissements de restauration. Les autres établissements pourront continuer leur activité, dans de nouvelles structures démontables après démolition des structures fixes en dur.
Attribution d’une concession de plage
Les plages faisant partie du domaine public maritime de l’État, leur exploitation touristique et l’installation de bâtiments ou d’équipements (paillote, restaurant, buvette, snack, notamment) sont soumises à une réglementation particulière et doivent faire l’objet d’une concession.
Concession de l’État
La plage doit faire l’objet d’une concession par l’État au moyen d’un arrêté préfectoral, après enquête publique.
Elle peut être concédée :
• soit à la métropole (en priorité), la commune ou le groupement de communes, qui prend en charge son aménagement et son entretien, pour y installer et exploiter des activités destinées à répondre aux besoins du service public balnéaire dans une zone d’activités municipales (Zam) ;
• soit à un autre concessionnaire, après publicité et mise en concurrence préalable, si la commune n’a pas fait valoir son droit de priorité.
La concession implique l’obligation d’aménager, d’entretenir et de sécuriser la plage, pour pouvoir l’exploiter ou la faire exploiter dans le respect de la réglementation en termes de sécurité et d’environnement.
Convention d’exploitation
S’ils n’exploitent pas eux-mêmes la plage concédée, la métropole, la commune ou le tiers concessionnaire peuvent à leur tour en confier l’exploitation commerciale à un sous-traitant (plagiste, restaurateur, commerçant, notamment) par une convention d’exploitation, après publication d’un cahier des charges, en contrepartie d’une redevance.
Le sous-traitant de plage peut être :
• une personne morale de droit public ou de droit privé ;
• une personne physique (commerçant, entrepreneur individuel…) ;
• un groupe de personnes physiques détenant en indivision les équipements ou installations de plage.
Conditions d’obtention
Pour obtenir l’attribution d’une concession de plage ou la signature d’une convention (généralement qualifiée de façon impropre de plage privée), l’exploitant doit :
• exercer une activité ayant un rapport direct avec l’exploitation de la plage ;
• permettre l’usage libre et gratuit de la plage, notamment en garantissant un accès libre des piétons à la mer : 80 % de la longueur du rivage et de la surface à mi-marée d’une plage naturelle doit rester sans installation ;
• respecter le caractère saisonnier de l’occupation du domaine public (limitée à 6 mois par an maximum), les installations, à l’exception des installations sanitaires publiques et des postes de sécurité, devant être démontées en période hivernale pour rendre au site son caractère naturel ;
• répondre aux impératifs de préservation des sites, des paysages du littoral, des ressources biologiques et des terrains avoisinants.
Durée d’une concession
La durée d’une concession (entre l’État et le concessionnaire) ne peut être supérieure à 12 ans et doit être renouvelée à son terme.
L’exploitation d’une concession de plage (selon la convention qui lie le concessionnaire et le sous-traitant) ne peut pas durer plus de 6 mois dans l’année.
Cependant, dans les stations touristiques classées, il est possible, sur délibération du conseil municipal, d’étendre la période d’exploitation jusqu’à 8 mois.
De plus, une station balnéaire classée, très fréquentée hors saison touristique, peut concéder des occupations à l’année, sans obligation de démontage annuel, à condition :
• d’être dotée d’un office de tourisme classé 4 étoiles depuis plus de 2 ans (avec un agrément préfectoral) ;
• de justifier de l’ouverture, par jour en moyenne, de plus de 200 chambres d’hôtels classés entre le 1er décembre et le 31 mars.
Source : Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)